Dig It! # 35

SLY AND THE FAMILY STONE
SLY AND THE
FAMILY STONE
En tout fan de rock’n’roll qui se respecte,
même le plus bourru, sommeille un coeur soul qui ne demande qu’à
palpiter, c’est bien connu. Or depuis quelques années, les gros
labels et des petits malins souvent transalpins rééditent
à tour de bras les héros soul des sixties et des seventies,
et en bon gros vinyle de compétition. Vu que le territoire mérite
d’être défriché, autant s’attaquer d’entrée
aux gros morceaux. C’est un peu la morale de cette nouvelle rubrique occasionnelle
qui permettra de réviser nos classiques. Histoire de démarrer
consensuel, on a choisi Sly Stone, un des plus influents piliers du funk,
celui qui osa baratter pop, doo-wop, rock, R&B, soul et psychédélisme
en une mixture pétaradante au point de tournebouler des milliers
de hippies éberlués en pleine nuit à Woodstock...
Une trajectoire de petit génie précoce, et maudit, bien sûr,
au bout du compte... Une alliance énergétique entre joie
de vivre et conscience sociale qui tourna au vinaigre... Mais en sept albums,
Sly et sa famille ont largement eu le temps de révolutionner la
musique noire.
FAMILY
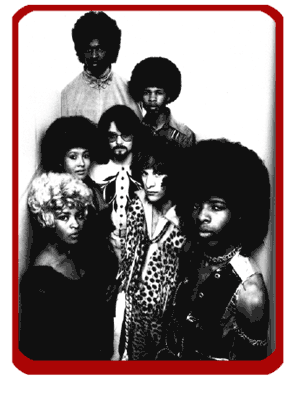 Sylvester
Stewart sortit son premier single, “On The Battlefield For My Lord”, en
1952 à l’âge de huit ans. La famille Stewart, originaire du
Texas, venait de débarquer à Vallejo, un peu au nord de San
Francisco, quand les quatre plus jeunes des cinq frères et soeurs,
Sylvester, Freddie, Rose et Vaetta se lancèrent dans le show-biz
sous le nom de The Stewart Four. Sly jouait déjà de la batterie
et de la guitare. Après ces débuts gospel, les deux frangins
poursuivent l’aventure dans différents groupes éphémères
dont les Stewart Brothers, qui enregistrent deux singles à Los Angeles
en 59. Tout en étudiant la musique (composition, théorie...
et trompette) au Vallejo Junior College, Sylvester joue notamment avec
le groupe rock Joey Piazza And The Continentals et chante avec The Viscaynes,
un groupe de doo-wop multi-culturel (des Blancs, un Noir, un Asiatique)
qui sort quelques 45 tours dont une version de “Yellow Moon” auréolée
d’un petit succès local. Il enregistre aussi sous le nom de Danny
Stewart. On trouve trace de tout ça sur les nombreuses compils de
fond de tiroir qui lui ont été consacrées, mais rien
de bien indispensable encore, le jeune Sylvester fait ses gammes.
Sylvester
Stewart sortit son premier single, “On The Battlefield For My Lord”, en
1952 à l’âge de huit ans. La famille Stewart, originaire du
Texas, venait de débarquer à Vallejo, un peu au nord de San
Francisco, quand les quatre plus jeunes des cinq frères et soeurs,
Sylvester, Freddie, Rose et Vaetta se lancèrent dans le show-biz
sous le nom de The Stewart Four. Sly jouait déjà de la batterie
et de la guitare. Après ces débuts gospel, les deux frangins
poursuivent l’aventure dans différents groupes éphémères
dont les Stewart Brothers, qui enregistrent deux singles à Los Angeles
en 59. Tout en étudiant la musique (composition, théorie...
et trompette) au Vallejo Junior College, Sylvester joue notamment avec
le groupe rock Joey Piazza And The Continentals et chante avec The Viscaynes,
un groupe de doo-wop multi-culturel (des Blancs, un Noir, un Asiatique)
qui sort quelques 45 tours dont une version de “Yellow Moon” auréolée
d’un petit succès local. Il enregistre aussi sous le nom de Danny
Stewart. On trouve trace de tout ça sur les nombreuses compils de
fond de tiroir qui lui ont été consacrées, mais rien
de bien indispensable encore, le jeune Sylvester fait ses gammes.
En 1963, il prend le pseudo de Sly Stone quand il devient DJ
pour la radio R&B de San Francisco, KSOL. Sa verve et sa tchatche largement
teintée d’argot lui assure une renommée croissante, et il
en profite pour glisser les Beatles, les Stones, Dylan ou Lenny Bruce parmi
les artistes noirs R&B habituels. Il sévit ensuite simultanément
sur KDIA à Oakland, et se fait remarquer par un ancien DJ, Big Daddy
Tom Donahue, dont le label Autumn Rds truste le top 40 de San Francisco.
Embauché comme producteur, il bosse avec des groupes blancs locaux
: les Beau Brummels, les Mojo Men, les Vejtables, les Tikis (voir les rééditions
Sundazed ou le Nuggets Vol 7), ou encore Bobby Freeman dont le single “C’mon
And Swim” (repris entre autres par les Woggles) devient un tube national.
Il produit aussi le “Someone To Love” de The Great Society (futurs Jefferson
Airplane), qui touchera le jackpot dans sa version ultérieure retitrée
“Somebody To Love”. Une légende rapportée par Greil Marcus
veut que Sly leur ait fait enregistrer près de deux cents prises
de la face B, “non parce que la chanson en valait la peine mais parce qu’il
n’aimait pas les riches hippies”. Seulement cinquante trois, a rectifié
le compositeur Darby Slick.
Sly est alors au coeur de la scène majeure de la baie,
entre garage pop psyché et acid rock, et depuis le temps qu’il y
traîne ses boots, il en connaît tous les lieux clés,
les studios, les radios, les clubs... Il continue à enregistrer
quelques 45 tours en solo, jusqu’en 66 où il forme Sly Stone &
The Stoners, avec entre autres sa petite amie la trompettiste Cynthia Robinson
(avec qui il aura une fille délicieusement dénommée
Sylvettha). Au même moment, brother Freddie tourne avec Freddie &
The Stone Souls dont le line-up inclut un jeune batteur blanc explosif,
Greg “Handsfeet” Errico. En 67, les deux frangins finissent par combiner
leurs groupes respectifs sur la suggestion d’un vieil ami de Sly, rencontré
à l’époque des Viscaynes, le saxophoniste Jerry Martini qui
intègre le nouveau projet : Sly & The Family Stone. Sly abandonne
la guitare au profit de Freddie et s’empare d’un orgue électrique
(il joue d’une douzaine d’instruments), puis il recrute le chanteur / bassiste
Larry Graham Jr, dont le style unique lui a été recommandé
par un auditeur (le “thumping” : il tape sur ses cordes, une astuce qu’il
utilise pour compenser l’absence de batterie quand il accompagne sa mère,
la pianiste et chanteuse Dell Graham). La petite soeur Vaetta veut aussi
en être, et Sly lui promet d’embaucher son groupe gospel The Heavenly
Tones, mais pas avant leur sortie du lycée. Les trois gamines deviendront
les choristes du gang sous le nom de Little Sister.
NEW
Le premier single, “I Ain’t Got Nobody”, sur Loadstone Rds, marche
plutôt bien dans la région et leur vaut un deal avec Epic.
Le premier LP est lancé sous une pochette chatoyante et un titre
prometteur : A Whole New Thing. Déjà le line-up sort de l’ordinaire.
Il associe Noirs et Blancs, ce qui était déjà courant
dans le jazz ou les groupes vocaux - les groupes maison de Motown et Stax,
respectivement les Funk Brothers et les MG’s étaient “intégrés”
eux aussi - mais beaucoup plus rare dans la sphère pop / rock. En
plus on y trouve une fille, chanteuse et instrumentiste. Encore plus rare
! C’est non seulement un gang totalement mixte (le premier dans toute l’histoire
du rock selon la bible All Music Guide To Soul), prônant la paix
et l’harmonie raciale, mais aussi un OVNI musical, cocktail d’influences
soul, R&B, gospel, pop et rock servi avec un enthousiasme juvénile.
La pochette et certains textes fleurent bon le Flower Power qui
s’est emparé de la baie. Mais l’énorme “Underdog”, qui sort
en single, sans faire un tabac, traite du racisme sur un ton assez noir si j’ose dire. Avec ses notes d’intro piquées
à “Frère Jacques”, son riff agressif et son refrain fragile,
c’est un monument de la soul (les Dirtbombs ne s’y sont pas trompés).
Et ce côté protest-song est plutôt rare à l’époque
dans le genre, même si Nina Simone avec “Mississippi Godamn” ou le
Mighty Hannibal avec “Hymn N°5” ont déjà montré
le chemin. Leurs paroles en tout cas tranchent avec celles plus légères
des hits de la Motown et de Stax. Musicalement, s’ils n’ont pas encore
dégotté la formule magique, Sly et sa bande expérimentent
en injectant dans leur “Trip To Your Heart” une bonne dose de psychédélisme
aigu. “If This Room...” préfigure lui les arrangements vocaux entre
doo wop et scat (bom bom bobom bobom bom bom...) qui les rendront célèbres,
et contient quelques bruitages bucaux qui rappellent les beats a cappella
du rap.
racisme sur un ton assez noir si j’ose dire. Avec ses notes d’intro piquées
à “Frère Jacques”, son riff agressif et son refrain fragile,
c’est un monument de la soul (les Dirtbombs ne s’y sont pas trompés).
Et ce côté protest-song est plutôt rare à l’époque
dans le genre, même si Nina Simone avec “Mississippi Godamn” ou le
Mighty Hannibal avec “Hymn N°5” ont déjà montré
le chemin. Leurs paroles en tout cas tranchent avec celles plus légères
des hits de la Motown et de Stax. Musicalement, s’ils n’ont pas encore
dégotté la formule magique, Sly et sa bande expérimentent
en injectant dans leur “Trip To Your Heart” une bonne dose de psychédélisme
aigu. “If This Room...” préfigure lui les arrangements vocaux entre
doo wop et scat (bom bom bobom bobom bom bom...) qui les rendront célèbres,
et contient quelques bruitages bucaux qui rappellent les beats a cappella
du rap.
A vingt-trois ans, Sly est maintenant un chanteur, auteur, compositeur,
arrangeur, producteur et multi-instrumentiste confirmé. Ce premier
opus lance la famille Stone sur les rails de la gloire, et sans être
aussi abouti et remuant que les trois suivants, il en pose les bases :
des cuivres saignants, une rythmique surpuissante, une guitare nerveuse,
une variété instrumentale réjouissante et plusieurs
voix (Sly, Freddie, Larry et puis Cynthia qui braille et lance des incantations)
se livrant à des duels et des acrobaties d’une liberté totale.
DANCE
La critique l’acclame mais les ventes sont décevantes.
Le label leur fait savoir qu’il serait bon d’enregistrer quelque chose
qui puisse faire un hit pop. Entre-temps Rose Stone se décide à
quitter son job dans un magasin de disques pour rejoindre sa fratrie. Elle
ajoute sa voix et son orgue électrique à la troupe. En février
68, Sly remplit son contrat en sortant l’emblématique “Dance To
The Music”, qui atteint le numéro 8 du Billboard. C’est leur premier
tube, un chef d’oeuvre iconoclaste et redoutablement efficace : énorme
basse fuzz, orgue crépitant, batterie mitraillette, cuivres qui
claquent, vocaux extatiques qui vous prennent à la gorge... Irrésistible.
Cette fois l’album (Dance To The Music) se vend plutôt
bien. Faut dire que c’est un euphorisant aux effets rarement égalés
depuis. En plus des brûlots “Ride”, “Color Me True”, ou “Don’t Burn
Baby”, et de quelques excursions vers le jazz ou la musique de foire, il
contient aussi le fameux “Dance To the Medley”. Au milieu de “Music Lover”,
ils lancent pour la première fois l’exhortation “I want to take
you higher higher higher...” Leur profession de foi... Des vocaux mantraïques,
des cuivres qui vrillent le cerveau, c’est l’extase... Le Nirvana du groove
! Il faut bien le final psychédélique pour atterrir.
Le groupe commence à tourner intensivement, se forgeant
une réputation aussi torride qu’un mois d’août toulousain.
Ils envoient des chorégraphies loufoques et déchaînées,
et portent des costumes excentriques, mi-hippies mi-carnaval, arborant
perruque blonde platine pour Rose, chapeau farfelu pour Freddie et coiffe
Afro luxuriante pour Sly. Ils plaisent aux Blancs pour leur côté
rock allumé, et aux Noirs pour leur chant gospel et revendicatif.
Ils voleront même la vedette à Jimi Hendrix lors d'une tournée
commune cette année-là.
Peut-être pour profiter de leur chance, ils balancent dans
la foulée un troisième LP, Life, qui fait un flop. C’est
pourtant un remake du précédent, dans le même esprit
joyeux, dansant, psyché et gorgé d’hormones, avec moultes
auto-références : “Dynamite” et “Love City” citent “Dance...”,
“M’Lady” lorgne sur “Music Lover”. On y retrouve aussi l’hypnotique “Into
My Own Thing” repris par DM Bob, l’amusant “Plastic Jim” qui cite lui “Eleanor
Rigby” des Beatles, ou les deux perles fraîches et groovy que sont
“Fun” et “Life”.
Pondus à quelques mois d’intervalle, Dance et Life font
entrer la soul dans une autre dimension : la “Psychedelic Soul”... Le producteur
de Motown Norman Whitfield y plonge avec les Temptations (“Cloud Nine”
fin 68) puis The Undisputed Truth. Leur influence s’étend aux Jackson
Five, Stevie Wonder ou Marvin Gaye, en passant par les Chambers Brothers
(créateurs de “Time Has Come Today” en 69), les Isley Brothers ou
encore peu après George Clinton et sa connection Parliament / Funkadelic.
Car en faisant exploser le cadre ultra-groove mais plutôt rigide
de James Brown, les nouveaux héros de San Francisco sont aussi en
train d’inventer le funk moderne.
STAND !
En 68, ils traversent l’Atlantique mais leur tournée en
Angleterre capote lorsque Larry Graham est arrêté pour possession
de Marijuana. Fin 68 le single “Everyday People” / “Sing A Simple Song”
atteint les sommets des charts. La face A est la quintessence de la soul
pop positive et un vibrant appel à la tolérance (une des
lignes, “Different strokes for different folks”, deviendra même une
expression courante). Le verso groove à mort sur un riff musclé.
On les retrouve en mai 69 sur le quatrième album que beaucoup considèrent
comme leur apogée, Stand !, qui se vend à plus de deux millions
d’exemplaires et restera classé dans les charts pendant deux ans.
Le morceau éponyme sort aussi en single et connaît
le même succès foudroyant. Mais la chanson la plus marquante
est “Don’t Call Me Nigger Whitey (Don’t Call Me Whitey Nigger)”, qui, comme
son titre l’indique, s’attaque encore au thème du racisme, en des
termes nettement plus offensifs, et déroule un groove rampant assez
saisissant. Les chants se chevauchent, la wah-wah gémit et Sly introduit
un nouveau gadget, une “talk box” électronique qui transforme sa
voix en un halètement oppressant. Celle-là, on l’entend peu
sur les ondes américaines à l’époque. La talk-box
réapparaît dans la longue jam “Sex Machine” au crescendo savamment
orchestré. Et ils reprennent leur credo avec frénésie
sur “I Want To Take You Higher”, où le chant qui tourne en boucle
est pour une fois submergé par la basse mammouthesque et les cuivres
lancinants. Retour au septième ciel du groove !
Si le ton se durcit parfois, Stand ! reste un cri de révolte
volontaire et enjoué... mais le vent tourne. Alors que Sly devient
une superstar, la génération flower power sombre, la guerre
continue au Vietnam, les émeutes raciales ont ravagé les
ghettos noirs des grandes cités américaines... Bien que doté
d’une mélodie gentillette et de textes innocents, le 45 tours suivant,
“Hot Fun In The Summertime”, semble bien y faire référence,
avec une ironie glacée. Sorti juste après leur prestation
restée mythique à Woodstock, le titre atteint la deuxième
place des charts pop.
BLACK

Le groupe est au sommet de la gloire mais des tensions apparaissent
entre les frères Stone et Larry Graham. De plus, le Black Panther
Party fait pression sur Sly en demandant l’éviction des deux Blancs,
Greg et Jerry. On parle aussi d’extorsion de fond, de bastons, de menaces
de mort... Sly se chope un ulcère et se tire à L.A. fin 69,
où il se soigne à grand renfort de cocaïne et, paraît-il,
de PCP (l’Angel Dust, l’anesthésique vétérinaire à
l’abominable réputation). Début 70, le groupe aligne encore
deux énormes tubes avec “Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)”
/ “Everybody Is A Star”. Ce dernier est dans une veine humaniste et positive,
nettement démentie par “Thank You...”, une adresse au public orthographiée
de façon fantasque (traduisez “Merci de m’avoir laissé redevenir
moi-même”), qui traite de la violence, du renoncement, de la trahison,
en reprenant ironiquement des titres de leurs chansons précédentes,
le tout sur un riff carton et sinueux. Un tournant dans le karma du gang,
et un morceau historique puisqu’il est considéré comme un
des premiers exemples de funk pur jus, et le premier où l’on entend
une basse jouée en “slapping” (dérivé du “thumping”
vous l’avez deviné). A vrai dire, c’est aussi de là que vient
l’horrible son de basse de la soul, du funk et de la disco des années
80 !
Sly annonce déjà le prochain album, The Incredible
And Unpredictable Sly And The Family Stone et promet qu’il sera le plus
optimiste de tous. Mais c’est lui qui devient imprévisible. En quittant
SF pour LA, il a changé de milieu. Il a alors la réputation
d’être défoncé toute la sainte semaine et de se trimballer
partout avec un étui à violon remplie de coke. Il engage
un membre de la mafia comme garde du corps, sabote quelques apparitions
télé, mais surtout, il plante son groupe lors de près
d’un tiers des concerts de l’année 1970. Certains de ses retards
ou de ses absences inopinées déclenchent des émeutes,
dont une très violente à Chicago. Son label tente de maintenir
le public sous pression en sortant de sa manche un Greatest Hits pendant
que Sly Stone fait un deal avec Atlantic et tente de transformer sa boîte
de production, Stone Flower, en label. Trois singles plus tard, il laisse
péricliter l’affaire, malgré deux beaux succès pour
Little Sister. Pour l’anecdote, leur remake de “Somebody’s Watching You”
serait le tout premier morceau où apparaît une boîte
à rythme.
Dans une des rares interviews disponibles sur le net, datant
de fin 70, on croise Sly en pleine panade : un show prévu à
Boston a été interdit par les autorités après
une émeute pour les Jackson Five la semaine précédente,
et à Detroit, où il avait décidé d’arriver
en limousine, les organisateurs ne le trouvant pas à l’aéroport
comme prévu ont choisi d’annuler. Il fanfaronne quand même,
asticote son manager Dave Krapalic, et clame sa foi en sa musique. “Ils
ne savent pas comment la catégoriser, ils ne peuvent pas dire que
c’est du R&B, ils ne peuvent pas dire que c’est du rock, ils ne peuvent
pas dire que c’est de la pop, parce que moi-même je ne sais pas ce
que c’est.” Krapalic suggère au journaliste Al Aronowitz de demander
à Sly pourquoi il n’a pas sorti d’album depuis deux ans. “Sly vit
dans le studio” répond ce dernier, en précisant qu’il est
en train de s’en construire un. Et quand on lui parle de l’Electric Lady
de Jimi Hendrix, il ajoute qu’il n’a pas besoin de vingt-quatre pistes
et que quatre lui suffisent bien. Puis il revient sur ses années
DJ : “J’ai eu ces mecs noirs qui appelaient et me disaient ‘Pourquoi tu
passes ces blanc-becs ?’ et je leur expliquais qu’il n’y a pas de Noirs
et qu’il n’y a pas de Blancs et si on doit tomber jusque là, il
n’y a personne de plus noir que moi. Il n’y a personne de plus noir que
Sly.”
RIOT
Le batteur Greg Errico est le premier à larguer la famille
début 71. Il figurera plus tard sur le premier album de Betty Davis
en compagnie de son compère Larry Graham, avant de devenir un batteur
de studio réputé travaillant pour Santana, Frampton ou Bowie.
Peu après, un nouveau single sort enfin. “Family Affair” devient
numéro un instantanément. Pourtant, cette histoire de couple
qui se déchire, chantée d’une voix résignée
sur fond de boîte à rythme n’a rien de franchement com-mercial.
Il est suivi fin 71 de l’album There’s A Riot Goin’ On, lui aussi classé
en haut des charts sur le champ. Le titre renvoie au refrain du classique
“Riot In Cell Block N°9”, mais on peut aussi y voir une réponse
à la complainte de Marvin Gaye, “What’s Going On”, sortie peu de
temps auparavant, alors que la violence submerge la lutte pour les droits
civiques. Et la réponse n’est pas jouasse.
Sly a tout fait tout seul ou presque, avec l’aide de la famille
sur quelques titres, et la participation de ses compagnons de débauche
Billy Preston et Ike Turner, plus son protégé Bobby Womack.
Celui-ci a raconté qu’ils avaient pris tellement de drogues pendant
les sessions qu’il n’en gardait pas le moindre souvenir. Le résultat
est une galette psychotrope, barrée, paranoïaque, flippante
et fascinante. Ou la preuve des effets néfastes de la drogue sur
la créativité, selon le point de vue. Un truc vraiment bizarre
en tout cas. Une rupture. Beaucoup de boîte à rythme, des
tempos lents et hypnotiques, des giclées d’orgues et de guitares
acides, des voix lancinantes, bruissantes ou glapissantes... Les textes
s’ancrent dans la violence urbaine, le radicalisme, le sarcasme... La rage
des Black Panthers, la poésie en plus, et un certain désespoir.
L’album se conclut par “Thank You For Talkin’ To Me Africa”, une relecture
hantée de l’autre “Thank You...”, au mixage étrange où
guitares et vocaux surgissent et s’évaporent tels des fantômes.
L’accueil des critiques et du public est contrasté. Certains hurlent
au génie, beaucoup sont décontenancés, d’autres outragés.
Son manager lance que Sly souffre d’un dédoublement de la personnalité.
D’ailleurs les morceaux sont signés S. Stewart / S. Stone. Les deux
autres 45t (dont “Runnin’ Away”, un bijou pop groovy qui échappe
à l’ambiance sombre du disque) se vendent aussi à pleines
brouettes. Mais c’est le début de la fin.
STAGGERLEE

Greil Marcus, le boss de Creem, a pondu en 75 un long article
intitulé Sly Stone : Le mythe de Staggerlee (une version française
revue et augmentée par l’auteur est parue en 2000 aux Editions Allia).
Il y rappelle d’abord la génèse de ce héros du folklore
noir, Staggerlee, le protagoniste d’innombrables blues, qui sous différents
noms et pour différents motifs toujours dérisoires, a assassiné
un certain Billy The Lion, un Black comme lui, un mythe basé sur
un fait divers qui se déroula à Saint-Louis à la fin
du XIXème siècle. Staggerlee est un homme cruel, mais au
fil des adaptations il devient celui qui n’a peur de rien, qui met en déroute
les shérifs blancs, et qui, s’il est finalement pendu, est accompagné
par les plus belles filles jusqu’au cimetière, puis va droit en
Enfer pour en chasser le diable et y installer un Paradis pour les Noirs.
Un fantasme de violence, de luxure et de liberté absolue.
Greil Marcus voit cette figure emblématique
resurgir dans les années 70 sous les traits des héros des
films de blaxploitation, Superfly, Sweet Sweetback, Slaughter... Et il
en décèle un écho chez Jimi Hendrix et Sly Stone.
Il dépeint ce dernier comme un type coriace, malin, échaudé
par le business du disque, ambitieux, sauvage et flamboyant, qui enfant
avait pris la tête d’un gang de rue puis participé aux émeutes
raciales lycéennes endémiques à Vallejo. Il survole
son ascension et ses premiers disques, puis s’attarde sur Riot, qu’il présente
comme “l’exploration et l’inventaire de l’état de la nation, de
la carrière de Sly, de son public, de la musique noire, de la politique
noire, et du monde blanc”. Il analyse ses paroles, ses rapports avec le
public, l’influence des “pulsions musicales de Riot” sur la la musique
noire, il rebondit sur les classiques de la Blaxploitation, et affirme
que “l’oeuvre de Sly a pénétré la politique noire
autant qu’elle a changé la musique noire et hanté le cinéma
noir”, en faisant un parallèle audacieux entre l’abandon du radicalisme
par les Black Panthers et l’album suivant de Sly. On n’est pas obligé
d’adhérer à toutes ses théories, mais on réécoute
le disque d’une autre oreille après avoir lu ce bouquin.
Une chose est sûre, Stand! et Riot, chacun à leur
façon, ont installé les bases du funk moderne : la basse
“slappée”, la wah wah, le groove élastique, les voix travaillées
dans l’aigu, des éléments que l’on retrouve chez George Clinton,
Curtis Mayfield, les premiers Earth Wind And Fire et Kool And The Gang,
toute la Motown des seventies, jusqu’à Prince, ou certaines gloires
du Hip Hop.
FAMILY AFFAIR
Début 72, Pat Rizzo rejoint le groupe au saxophone afin
de pallier à une éventuelle défection de Jerry Martini
qui soupçonne Sly et ses managers de le rouler sur ses royalties.
Plus tard dans l’année, lors d’une sérieuse altercation,
Larry Graham doit s’enfuir avec sa femme par une fenêtre d’hôtel.
Il ne reviendra pas, préférant voler de ses propres ailes
avec Graham Central Station. Bobby Womack assure l’interim avant de laisser
sa place à Rusty Allen. Les quatre Stone sont toujours là
mais l’esprit de famille en a pris un coup.
Fresh, le successeur de Riot, ressemble encore à un album
solo. Moins envapé et plus apaisé, et du coup, à vrai
dire, moins passionnant, il contient de très belles lignes mélodiques
chaloupées sur fond de boîte à rythmes, une cover gospel
soul de “Que Sera Que Sera” chantée en duo avec sa frangine Rose,
et un hit “If you Want Me To Stay” qui n’atteint que le top 20. Certains
fans de funk considèrent aujourd’hui qu’il est un classique sous-estimé
du genre.
Durant ces années 70, leurs tournées ont été
totalement erratiques. Les promoteurs ont tellement flippé en priant
que Sly soit bien là, qu’il ne quitte pas la scène au bout
d’un quart d’heure en maugréant contre le public, que les autres
acceptent aussi de jouer, et qu’aucun ne s’évanouisse sur scène,
qu’ils n’avancent plus un rond. Le groupe est passé des stades aux
salles plus modestes. En 74, Sly remplit quand même le Madison Square
Garden en épousant Kathleen Silva devant 21 000 spectateurs. Ils
posent tous deux avec leur enfant sur la couverture de Small Talk qui s’ouvre
sur les gazouillis du bébé. Cette fois la famille est bien
présente, recomposée avec Bill Lordan à la batterie
et l’adjonction du violoniste Sid Page. Ils essaient par moments de renouer
avec le style joyeusement pêchu des débuts mais la flamme
flageole, et l’album est déjà du funk générique.
Il se vend beaucoup moins bien, malgré le coup de pub du mariage
on stage. Du reste Sly et Kathleen se sépareront quelques mois plus
tard. En 1975, après un concert calamiteux devant une salle quasiment
vide, la famille Stone éclate définitivement.
STONED
La suite est une longue dégringolade marquée de
quelques éclairs : quatre autres albums en solo, ou en pseudo-reformation,
de moins en moins remarqués, une compil de remix disco des tubes
des débuts éditée en 79 pour clôturer le contrat
avec Epic, un passage sur Warner, des tournées avec George Clinton
et une apparition sur un album de Funkadelic (The Electric Spanking Of
War Babies) au début des années quatre-vingt, des problèmes
de santé récurrents, plusieurs arrestations pour possession
de cocaïne, une cure de désintoxication en 84 sous l’égide
de Bobby Womack, un vrai-faux retour annoncé par A&M l’année
suivante, des mandats d’amener pour absence au tribunal, de nouvelles arrestations,
quelques séjours en tôle pour usage de drogue et pensions
alimentaires non payées, une fuite rocambolesque au Connecticut
pour échapper à une nouvelle affaire de cocaïne qui
lui vaut un séjour de quatorze mois dans un centre spécialisé...
Sa dernière apparition publique date semble-t-il de 1993
lors de l’introduction de Sly & The Family Stone dans le Rock &
Roll Hall Of Fame. Il surgit à la dernière seconde tandis
que ses anciens compères poireautent sur scène, avant de
prononcer trois mots et de s’éclipser. Plusieurs rumeurs prétendent
qu’il habite alors dans un foyer d’accueil, qu’il a souffert de troubles
mentaux, ou encore qu’il prépare un come back fracassant et qu’il
a des heures d’enregistrements en stock, mais malgré un deal en
95 avec Avenue Rds, rien de nouveau ne voit le jour.
Marcus raconte qu’en 1998, Sly a contacté un fan
qui lui avait consacré un site web pour le faire venir à
LA et lui jouer des inédits. Le fan raconta ensuite à Rolling
Stone que ces nouveaux morceaux étaient bons à vous arracher
des larmes. Il ne restait de la famille que deux groupes hommage regroupant
différents anciens membres : The Phunk Family et The Family Stone
Experience. Une reformation quasi-complète eut lieu en 2003 pour
un nouvel album. Ne manquaient que Larry Graham, et Sly lui-même
bien sûr. Staggerlee s’est fait choper. Il est en Enfer en train
de régler son compte au Diable.
Sylvain Coulon
www.slystone.com
www.slystonemusic.com
 (Retour à la page articles principale)
(Retour à la page articles principale)

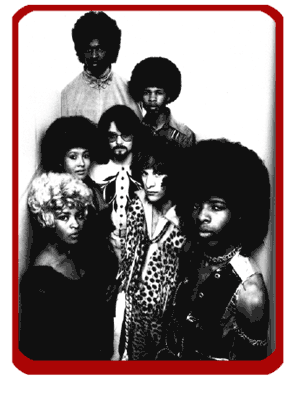 Sylvester
Stewart sortit son premier single, “On The Battlefield For My Lord”, en
1952 à l’âge de huit ans. La famille Stewart, originaire du
Texas, venait de débarquer à Vallejo, un peu au nord de San
Francisco, quand les quatre plus jeunes des cinq frères et soeurs,
Sylvester, Freddie, Rose et Vaetta se lancèrent dans le show-biz
sous le nom de The Stewart Four. Sly jouait déjà de la batterie
et de la guitare. Après ces débuts gospel, les deux frangins
poursuivent l’aventure dans différents groupes éphémères
dont les Stewart Brothers, qui enregistrent deux singles à Los Angeles
en 59. Tout en étudiant la musique (composition, théorie...
et trompette) au Vallejo Junior College, Sylvester joue notamment avec
le groupe rock Joey Piazza And The Continentals et chante avec The Viscaynes,
un groupe de doo-wop multi-culturel (des Blancs, un Noir, un Asiatique)
qui sort quelques 45 tours dont une version de “Yellow Moon” auréolée
d’un petit succès local. Il enregistre aussi sous le nom de Danny
Stewart. On trouve trace de tout ça sur les nombreuses compils de
fond de tiroir qui lui ont été consacrées, mais rien
de bien indispensable encore, le jeune Sylvester fait ses gammes.
Sylvester
Stewart sortit son premier single, “On The Battlefield For My Lord”, en
1952 à l’âge de huit ans. La famille Stewart, originaire du
Texas, venait de débarquer à Vallejo, un peu au nord de San
Francisco, quand les quatre plus jeunes des cinq frères et soeurs,
Sylvester, Freddie, Rose et Vaetta se lancèrent dans le show-biz
sous le nom de The Stewart Four. Sly jouait déjà de la batterie
et de la guitare. Après ces débuts gospel, les deux frangins
poursuivent l’aventure dans différents groupes éphémères
dont les Stewart Brothers, qui enregistrent deux singles à Los Angeles
en 59. Tout en étudiant la musique (composition, théorie...
et trompette) au Vallejo Junior College, Sylvester joue notamment avec
le groupe rock Joey Piazza And The Continentals et chante avec The Viscaynes,
un groupe de doo-wop multi-culturel (des Blancs, un Noir, un Asiatique)
qui sort quelques 45 tours dont une version de “Yellow Moon” auréolée
d’un petit succès local. Il enregistre aussi sous le nom de Danny
Stewart. On trouve trace de tout ça sur les nombreuses compils de
fond de tiroir qui lui ont été consacrées, mais rien
de bien indispensable encore, le jeune Sylvester fait ses gammes.

 racisme sur un ton assez noir si j’ose dire. Avec ses notes d’intro piquées
à “Frère Jacques”, son riff agressif et son refrain fragile,
c’est un monument de la soul (les Dirtbombs ne s’y sont pas trompés).
Et ce côté protest-song est plutôt rare à l’époque
dans le genre, même si Nina Simone avec “Mississippi Godamn” ou le
Mighty Hannibal avec “Hymn N°5” ont déjà montré
le chemin. Leurs paroles en tout cas tranchent avec celles plus légères
des hits de la Motown et de Stax. Musicalement, s’ils n’ont pas encore
dégotté la formule magique, Sly et sa bande expérimentent
en injectant dans leur “Trip To Your Heart” une bonne dose de psychédélisme
aigu. “If This Room...” préfigure lui les arrangements vocaux entre
doo wop et scat (bom bom bobom bobom bom bom...) qui les rendront célèbres,
et contient quelques bruitages bucaux qui rappellent les beats a cappella
du rap.
racisme sur un ton assez noir si j’ose dire. Avec ses notes d’intro piquées
à “Frère Jacques”, son riff agressif et son refrain fragile,
c’est un monument de la soul (les Dirtbombs ne s’y sont pas trompés).
Et ce côté protest-song est plutôt rare à l’époque
dans le genre, même si Nina Simone avec “Mississippi Godamn” ou le
Mighty Hannibal avec “Hymn N°5” ont déjà montré
le chemin. Leurs paroles en tout cas tranchent avec celles plus légères
des hits de la Motown et de Stax. Musicalement, s’ils n’ont pas encore
dégotté la formule magique, Sly et sa bande expérimentent
en injectant dans leur “Trip To Your Heart” une bonne dose de psychédélisme
aigu. “If This Room...” préfigure lui les arrangements vocaux entre
doo wop et scat (bom bom bobom bobom bom bom...) qui les rendront célèbres,
et contient quelques bruitages bucaux qui rappellent les beats a cappella
du rap.


 (Retour à la page articles principale)
(Retour à la page articles principale)